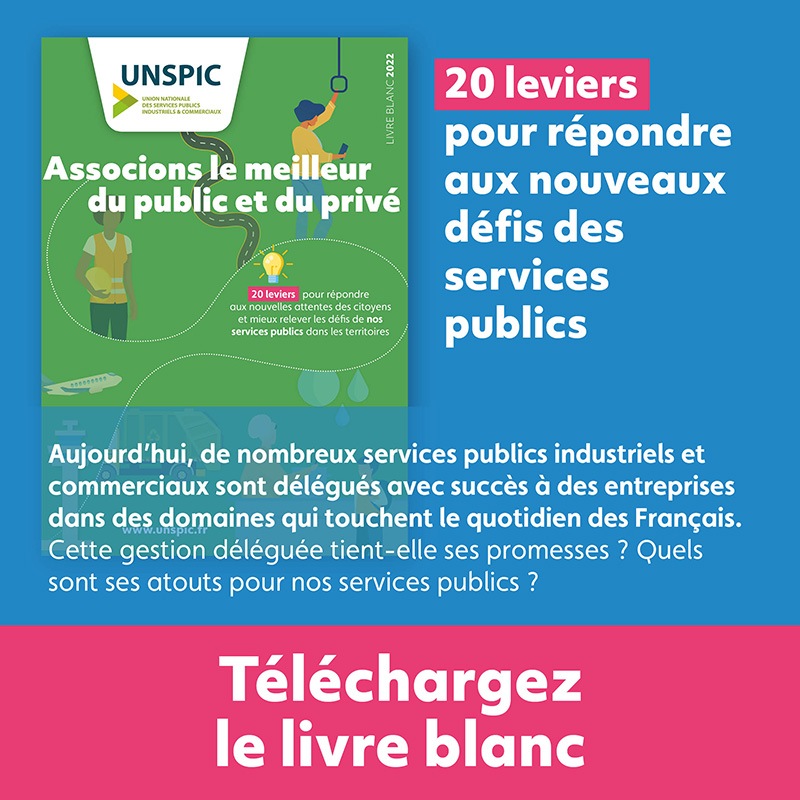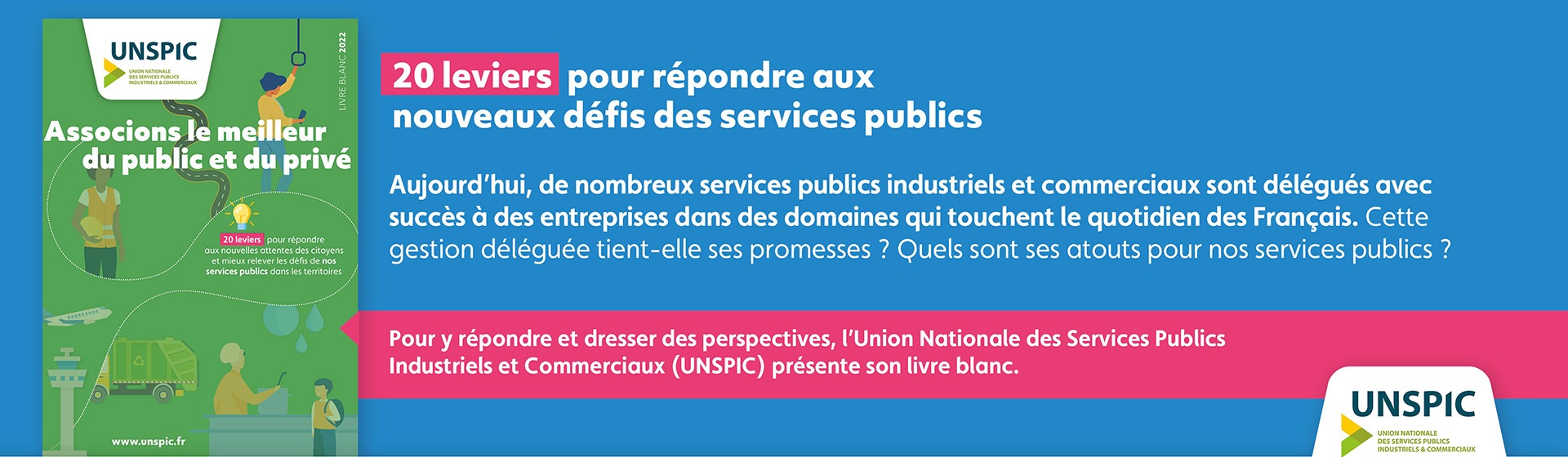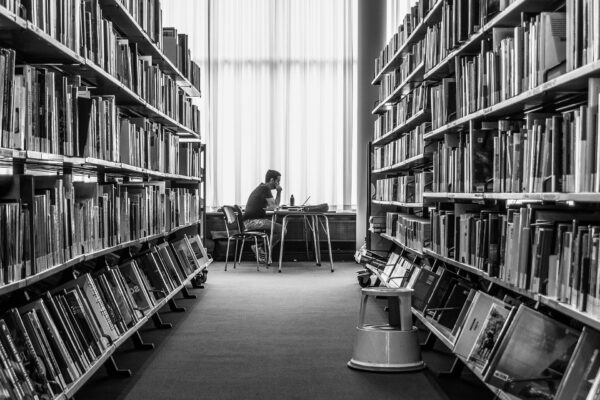3 questions à Christophe JERRETIE, Député, Vice-président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de l’Assemblée Nationale, conseiller municipal de Naves, conseiller communautaire de Tulle Agglo
Le grand débat national a été marqué par la question de l’accès et de la qualité de services publics pour les usagers, et une injonction forte de la part des contribuables pour une diminution des impôts. Comment nos services publics au niveau local peuvent-ils aujourd’hui relever les défis auxquels ils sont confrontés ?
Quand on parle de performance dans le service public, il faut s’intéresser aux résultats : le service cible-t-il la bonne population ? La collectivité rend-elle bien le service dont les usagers ont besoin ? Un premier élément est donc de calibrer le service en fonction des objectifs poursuivis et s’assurer qu’il va dans le sens de l’intérêt général, qu’il soit utile à une majorité de la population car il est financé par l’impôt.
L’évaluation des services publics est une nécessité dans toutes nos collectivités. Outre l’enjeu financier, qui est une préoccupation de l’Etat comme des collectivités locales, cette évaluation doit mesurer la qualité du service rendu.
Ainsi, je fais la distinction entre les services collectifs (rendus de manière plus uniforme et générale à l’ensemble des usagers, comme le service d’eau ou de collecte des déchets pour les collectivités territoriales ou l’éducation pour l’Etat) et les services individualisés, qui nécessitent un traitement différencié selon les usagers (comme le service des impôts, les services sociaux pour les collectivités territoriales).
De manière générale, les services individualisés pour l’Etat, sont moins faciles à évaluer. A travers les rapports annuels de performances (RAP) qui présentent les résultats des administrations au regard des engagements pris en loi de finances initiale, on évalue les grandes masses financières, alors qu’il conviendrait d’évaluer plus finement le service rendu aux usagers de ces services. Il y a une vraie marge de progression sur ce sujet.
On a eu tendance en France à créer de nouveaux services publics ou développer les services existants sans poser la question de supprimer des services moins utilisés ou devenus inutiles. La question de la rationalisation des services publics existants doit être posée. Chaque service devrait être évalué et son existence questionnée au regard de son utilité, de son rapport qualité/coût et de sa performance dans le domaine de la satisfaction des usagers.
De plus, la décentralisation aurait dû mieux permettre cet ajustement.
N’y a-t-il pas, au sein des collectivités locales, un risque de voir la recherche d’économie prendre le pas sur la qualité de service et la recherche de performance ?
Les élus savent que quand on est dans une logique pure de recherche d’économies, on risque de déprécier la qualité de service.
Il est plus facile pour les élus locaux, notamment au sein du bloc communal, d’identifier les besoins et le bon niveau de service à mettre en place. Ces derniers disposent en général des moyens pour ajuster les services à leur population. Par ailleurs, les collectivités ont l’habitude de développer des enquêtes de satisfaction auprès des usagers et connaissent donc bien les attentes.
Il y a une sorte de réajustement perpétuel de la décentralisation : les collectivités locales se voient transférer au fil du temps la gestion de services de proximité. Aujourd’hui, l’enjeu pour les services publics locaux est de s’investir davantage sur ces nouveaux enjeux. Le mouvement des Gilets jaunes a ainsi montré qu’il y avait de fortes attentes dans le domaine de l’accès au haut débit ou à davantage de mobilité sur les territoires. De même, les usagers sont en attente d’outils numériques adaptés pour l’usage des services publics. Les collectivités doivent davantage s’emparer de ces sujets qui correspondent à des vrais besoins actuels et la demande de la population.
Quelles sont vos recommandations ou bonnes pratiques pour promouvoir la performance dans les services publics locaux ?
J’observe que la comptabilité analytique des collectivités se développe. C’est un point positif, car pour évaluer la performance d’un service public, il convient de savoir connaitre la totalité des charges. La comptabilité des collectivités locales doit être beaucoup plus précise qu’auparavant.
Il convient également de développer les contrats d’objectifs et de moyens. C’est ce que nous avons fait avec la contractualisation financière entre l’Etat et les collectivités locales. Nous avons mis par écrit des objectifs chiffrés qui permettent ensuite de mettre en face les moyens nécessaires. Ces contrats sont de véritables outils de pilotage et pas uniquement de contraintes.
Par ailleurs, quel que soit le mode de gestion (mode intégré dans les services de la collectivité ou mode prestataire ou délégation), il faut aujourd’hui remettre à plat l’intégralité du service tous les cinq ans pour voir comment il a évolué et observer s’il répond toujours aux objectifs….
Au final, pour évaluer le service, il s’agit d’observer les grands indicateurs économiques du service, de les croiser avec la satisfaction des bénéficiaires (besoins et demandes globales de la population) et les objectifs annexes fixés par les collectivités (exigences environnementales par exemple).
Le développement d’indicateurs de performance constitue un gage de la réussite du fonctionnement des services publics locaux aujourd’hui. L’évolution de la société humaine et de la technologie replace continuellement les services publics dans de nouveaux contextes.